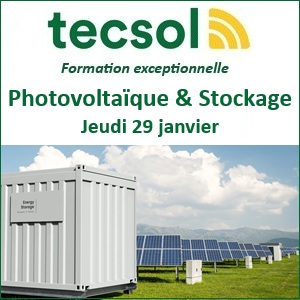Lors de l’Université de l’autoconsommation organisée par Enerplan, une table ronde rassemblait, face au public, les principaux acteurs institutionnels et professionnels du solaire en France. Parmi les intervenants figuraient Dries Acke (Solar Power Europe), Laetitia Brottier (Enerplan / Dualsun), Jean-Luc Fugit (député du Rhône, président du Conseil supérieur de l’énergie), Christophe Gros (Enedis) et Laurent Kueny (Directeur de l’énergie à la DGEC). La discussion, riche, a mis en lumière les défis concrets de l’autoconsommation électrique dans le contexte français et européen.
L’autoconsommation : un levier stratégique… mais encore freiné
Pour ouvrir le débat, Dries Acke a posé le cadre européen : l’autoconsommation est désormais une pièce centrale de la stratégie de déploiement des énergies renouvelables en Europe. Cependant, selon lui, la France accuse un certain retard dû à une réglementation nationale, des tarifs de réseau élevés et une fiscalité complexe. Il a insisté sur la nécessité d’harmoniser les cadres réglementaires européens afin d’assurer un marché clair et stable pour les investisseurs.
Laetitia Brottier a ensuite partagé le point de vue du terrain : pour Dualsun et les autres membres d’Enerplan, les obstacles demeurent dans les cadres administratifs, les coûts de raccordement et l’incertitude sur le retour sur investissement. Elle a appelé à une plus grande lisibilité des mécanismes de soutien (tarifs, primes, aides locales) et à une simplification des démarches pour les particuliers et les entreprises souhaitant installer des systèmes d’autoconsommation.
L’enjeu politique : du discours aux actes législatifs
Jean-Luc Fugit, en tant que député et président du Conseil supérieur de l’énergie, a apporté une perspective institutionnelle. Il a rappelé les efforts législatifs en cours pour favoriser l’autoconsommation, mais a reconnu que le cadre légal doit encore évoluer pour accompagner une montée en puissance fiable. Il a notamment évoqué la nécessité de mieux articuler les schémas régionaux (S3REnR) avec la planification des réseaux.
Pour M. Fugit, l’autoconsommation ne doit pas être perçue comme une entrave à la stabilité du système, mais comme un complément utile, surtout si les données de production sont partagées avec les gestionnaires de réseau afin de piloter la charge. Il s’est dit favorable à l’expérimentation de tarifs dynamiques favorisant les consommateurs producteurs.
Le rôle des gestionnaires de réseau : vision pragmatique
Christophe Gros, représentant Enedis, a apporté un regard opérationnel souvent écouté avec attention. Il a reconnu que le changement de paradigme (multiplication de petits producteurs décentralisés) impose une adaptation des réseaux.
Son propos : pour qu’un basculement vers l’autoconsommation généralisée soit viable, il faut des mécanismes d’équilibrage local, des investissements dans les infrastructures intelligentes (smart grids), et surtout une bonne coordination entre opérateurs et producteurs. Il a souligné que pour l’instant, les gestionnaires de réseau doivent souvent absorber les fluctuations sans compensation claire, ce qui pèse sur leurs coûts.
Gros a également évoqué la question du tarif d’utilisation des réseaux (TURPE) : selon lui, une réforme s’impose pour que les coûts fixes du réseau ne pénalisent pas les petits producteurs d’énergie solaire. Sans cela, l’autoconsommation pourrait rester un “niche” réservée à ceux qui ont un capital financier.
Le point de vue de l’administration : cap sur la stabilité réglementaire
Enfin, Laurent Kueny, au nom de la DGEC (Direction Générale de l’Énergie et du Climat), est intervenu pour rassurer les acteurs : la stratégie nationale prévoit de continuer à soutenir l’autoconsommation, dans le cadre de la PPE (Programmation pluriannuelle de l’énergie). Il a rappelé que l’État souhaite renforcer l’articulation entre les dispositifs existants (aides locales, appels d’offres, tarifs, soutien au stockage) pour donner plus de visibilité.
Laurent Kueny a aussi annoncé que la DGEC allait lancer des consultations autour de tarifs d’incitation modulés selon la taille des installations et les zones géographiques. Enfin, il a insisté sur l’importance d’un dialogue continu entre l’État, les régulateurs, les exploitants et les collectivités pour assurer la confiance des investisseurs.
Entre opportunités et vigilance
Cette table ronde a montré que l’autoconsommation est aujourd’hui non seulement une solution technique pertinente, mais également un enjeu politique et économique. Si les déséquilibres de réglementation, les coûts de raccordement et les incertitudes fiscales restent des freins, tous les participants ont convenu que la dynamique était lancée.
Pour aller plus loin, il faudra transformer les paroles en actes : clarifier les cadres, adapter les tarifs réseau, améliorer la gouvernance locale, et sécuriser les signaux d’investissement. Car dans la transition énergétique, l’autoconsommation pourrait bien passer du statut de complément décoratif à celui de socle de la production électrique partagée.