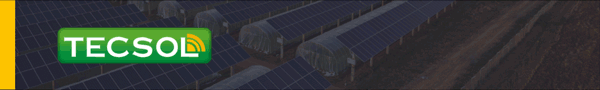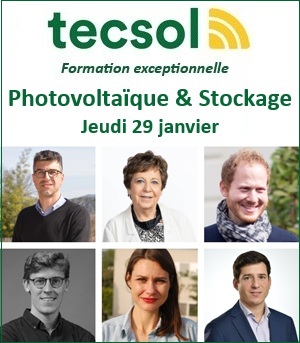Invité du Greenletter Club, le physicien Daniel Suchet, professeur à l’École polytechnique et chercheur à l’Institut Photovoltaïque d’Île-de-France (IPVF), replace le solaire dans le temps long et dans les réalités techniques du présent. De l’expérience d’Edmond Becquerel en 1839 à l’explosion des capacités installées depuis vingt ans, « le photovoltaïque est la seule technologie d’électricité qui convertit directement la lumière en courant, sans pièces mobiles », rappelle-t-il. Cette particularité explique une maintenance limitée et une industrialisation rapide par rapport aux moyens fondés sur des machines tournantes (thermique, hydraulique, éolien).
La dynamique est spectaculaire : « Fin 2022, le monde comptait environ 1 térawatt (TW) installé ; fin 2024, 2,2 TW. En deux ans, on a ajouté plus que tout ce qui avait été posé avant 2022. » La Chine a joué un rôle décisif en développant sa propre filière silicium et en tirant les coûts vers le bas. Résultat : le solaire fournit désormais autour de 5 % de l’électricité mondiale, « encore loin d’un monde alimenté par le soleil, mais sur une trajectoire exponentielle », nuance Daniel Suchet, vigilant sur les extrapolations.
En France, RTE projette un quadruplement à un facteur 20 d’ici 2050 selon les scénarios. L’enjeu n’est plus de prouver la compétitivité — « le coût actualisé de l’énergie photovoltaïque est désormais très bas, surtout au sol » — mais d’intégrer des volumes croissants sur un réseau conçu pour des centrales pilotables. Daniel Suchet propose de « penser par échelles de temps ».
À court terme, l’intermittence (nuage, passage horaire) se gère par flexibilité, batteries de courte durée et électronique de puissance (inertie synthétique). À l’échelle saisonnière, la complémentarité avec l’éolien « qui produit davantage en hiver » lisse le profil annuel, sans résoudre les à-coups de demi-heure en demi-heure. Et il prévient : « Les effets système deviennent sensibles autour de 50 GW cumulés éolien+solaire : nous y sommes. »
Sur le potentiel, l’abondance théorique est « colossale », mais l’énergie solaire est diffuse : il faut de la surface. Les repères utiles : « 1 hectare ≈ 1 MWc, ≈ 1 GWh/an, ≈ 1 M€ d’investissement » pour une centrale au sol bien exposée. D’où la priorité aux surfaces déjà artificialisées (toitures industrielles, ombrières, friches) et une approche pragmatique de l’agrivoltaïsme, à condition « d’un bénéfice agronomique réel » et de garde-fous pour éviter la simple rente foncière.
Côté performances, les panneaux commerciaux atteignent 20–22 % de rendement, contre une limite pratique d’environ 29 % pour le silicium. Les cellules « tandem » (empilement de matériaux) ouvriront de la marge « avec des parts de marché significatives attendues à l’horizon 2035 ».
L’intérêt est économique autant que physique : « Le coût du module a chuté d’un facteur mille en quarante ans ; aujourd’hui, ce sont l’installation, le raccordement et le capital qui pèsent. Un meilleur rendement réduit la matière, les surfaces et les BOS (balance-of-system). »
La question industrielle est centrale : « Aujourd’hui, le photovoltaïque, c’est du silicium… et c’est chinois. » Pour relocaliser en Europe, il faudra « accepter un surcoût au nom de la souveraineté », sachant que la cellule ne représente qu’une fraction du coût total et que « l’installation et l’exploitation créent de la valeur localement ».
Sur les matériaux, pas de « drapeau rouge » géologique à court terme : l’enjeu est d’abord industriel (capacité à produire verre, aluminium, silicium, et à recycler). On sait déjà démonter les cadres et le verre ; « le vrai défi est de remonter la chaîne jusqu’aux cellules pour récupérer l’argent et revaloriser le silicium à l’échelle industrielle ».
Enfin, Daniel Suchet insiste sur la demande : électrifier vite (mobilité, chaleur) et déplacer des usages. L’exemple historique des chauffe-eau nocturnes peut inspirer « une flexibilité vers le milieu de journée quand le PV produit ». La climatisation, très consommatrice, pourrait être mieux synchronisée à l’ensoleillement « à condition d’avoir des bâtiments conçus pour le confort d’été ». Le solaire, conclut-il, « n’est pas seulement des kWh bon marché ; c’est une acculturation, une technologie modulaire qui met la société au contact de sa production d’énergie ». Reste à aligner réseau, industrie et usages avec ce changement d’échelle.