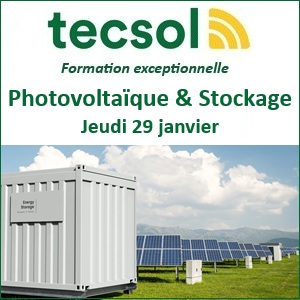Une intervention marquante de l’Université d’Enerplan, désormais disponible en vidéo.
Lors de l’Université d’Enerplan, Nicolas Goldberg, analyste et entrepreneur reconnu dans le domaine de l’énergie, a livré une réflexion dense et pragmatique sur le développement de l’autoconsommation solaire. Son message : il est temps de passer de la phase expérimentale à une logique de déploiement structuré et coordonné.
Vers un modèle de production locale
Pour Nicolas Goldberg, l’autoconsommation n’est plus un supplément décoratif au réseau électrique national, mais un pilier de l’équilibre futur. Produire et consommer localement devient un enjeu stratégique autant pour les ménages que pour les collectivités.
Il rappelle que le véritable défi consiste à faire coïncider la production photovoltaïque et la demande réelle, grâce à une planification fine des usages : recharge de véhicules électriques, pilotage du chauffage, fonctionnement des pompes à chaleur ou des appareils électroménagers.
« L’autoconsommation n’a de sens que si elle s’intègre dans une organisation globale de la consommation », résume-t-il.
L’ajustement de la demande : un levier clé
Nicolas Goldberg insiste sur la flexibilité : il ne s’agit plus d’adapter uniquement la production au réseau, mais aussi la consommation aux moments où le soleil brille.
Cette synchronisation suppose de nouveaux outils : compteurs communicants, systèmes de pilotage automatisés, contrats d’effacement et signaux tarifaires adaptés. Les particuliers comme les entreprises doivent être encouragés à déplacer certains usages vers les heures solaires, plutôt que d’accumuler des surplus mal valorisés.
Stocker, mais avec discernement
Sur la question du stockage, l’expert se montre prudent. Les batteries jouent un rôle utile pour lisser la production sur la journée, éviter les pointes et stabiliser le réseau local. Mais elles ne peuvent pas tout : leur coût reste élevé, et elles ne répondent pas au déséquilibre saisonnier entre l’hiver et l’été.
Pour Nicolas Goldberg, le stockage doit être vu comme un outil d’optimisation, non comme la solution miracle. La complémentarité entre solaire, éolien et autres sources reste indispensable pour sécuriser l’approvisionnement.
Simplifier et clarifier les règles du jeu
L’un des freins majeurs au développement de l’autoconsommation reste administratif. Nicolas Goldberg dénonce les délais de raccordement, la complexité des formulaires, la multiplicité des interlocuteurs.
Il appelle à « un choc de simplification » et à une plus grande lisibilité économique : les tarifs de rachat, les coûts d’étude et les conditions d’accès au réseau doivent être clarifiés et harmonisés.
L’objectif : faire en sorte qu’un particulier, une entreprise ou une collectivité puisse investir sans incertitude juridique ni blocage technique.
Mutualiser les installations et les usages
Nicolas Goldberg plaide aussi pour une approche collective : coopératives citoyennes, toitures partagées, parkings solaires ou projets d’autoconsommation de quartier. Ces initiatives permettent d’optimiser les surfaces disponibles, de répartir les coûts et de créer des bénéfices communs.
« C’est dans la mutualisation que se trouve la robustesse du modèle », souligne-t-il, rappelant que le photovoltaïque, par sa modularité, s’adapte aussi bien à une maison qu’à une zone d’activités.
Un enjeu industriel et de souveraineté
Enfin, l’expert alerte sur la dépendance européenne aux importations asiatiques. Aujourd’hui, l’essentiel des cellules photovoltaïques provient de Chine. Pour Nicolas Goldberg, il est crucial de soutenir la fabrication locale — de la cellule au module — et de relancer une filière industrielle complète en Europe.
« Si nous voulons garder la maîtrise de nos infrastructures électriques, nous devons aussi maîtriser les outils de production », insiste-t-il.
En conclusion, Nicolas Goldberg appelle à une vision d’ensemble : l’autoconsommation n’est pas une mode, mais un changement d’échelle dans la manière de produire et d’utiliser l’électricité.
Elle implique de nouveaux réflexes, des cadres réglementaires modernisés et une industrie capable d’en soutenir l’essor.
Un chantier collectif, à la croisée de la technique, de l’économie et du bon sens, pour construire un système électrique plus sobre, plus local et plus résilient.